Skip to content
Infrastructure & Flux
Réseaux
Comprendre comment les données transitent à travers le monde.
Des câbles LAN aux tunnels VPN chiffrés, en passant par l'analyse de paquets et le Modèle OSI.
ProtocolesTCP/IP & UDP
SécuritéFlux & Accès
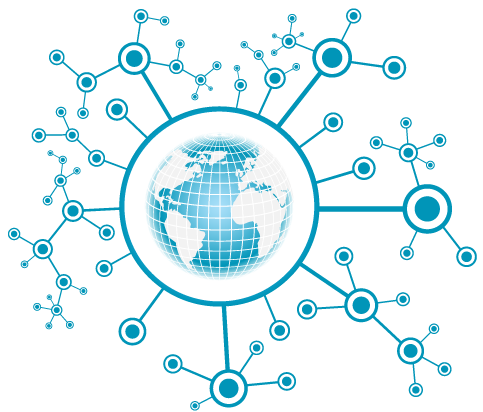
Contribuez à ces cours !
Ce projet est Open Source. Vous pouvez ajouter du contenu, corriger une erreur ou proposer une amélioration directement sur GitHub.
Ingénierie Réseau
Du câblage physique aux protocoles de chiffrement avancés.
📕 Fondamentaux & Architecture
Les bases théoriques et physiques de la communication numérique.
⚙️ Protocoles & Services
Les mécanismes qui font tourner le web et les infrastructures.
🔐 Cryptographie & VPN
Sécuriser la confidentialité et l'intégrité des échanges.
🛡️ Durcissement (Hardening)
Réduire la surface d'attaque des équipements réseaux.
💎 Sécurité Avancée
Stratégies de défense périmétrique et zéro confiance.
Architecture AvancéeConception résiliente et redondante.→Next-Gen FirewallsFiltrage applicatif (Layer 7) et inspection DPI.→NIDS & NIPSDétection et Prévention d'intrusions réseau.→Proxy / MandataireIntermédiation, cache et filtrage web.→Zero TrustLe principe 'Ne jamais faire confiance, toujours vérifier'.→
🔧 Dépannage (Troubleshooting)
Identifier et résoudre les incidents de connectivité.
